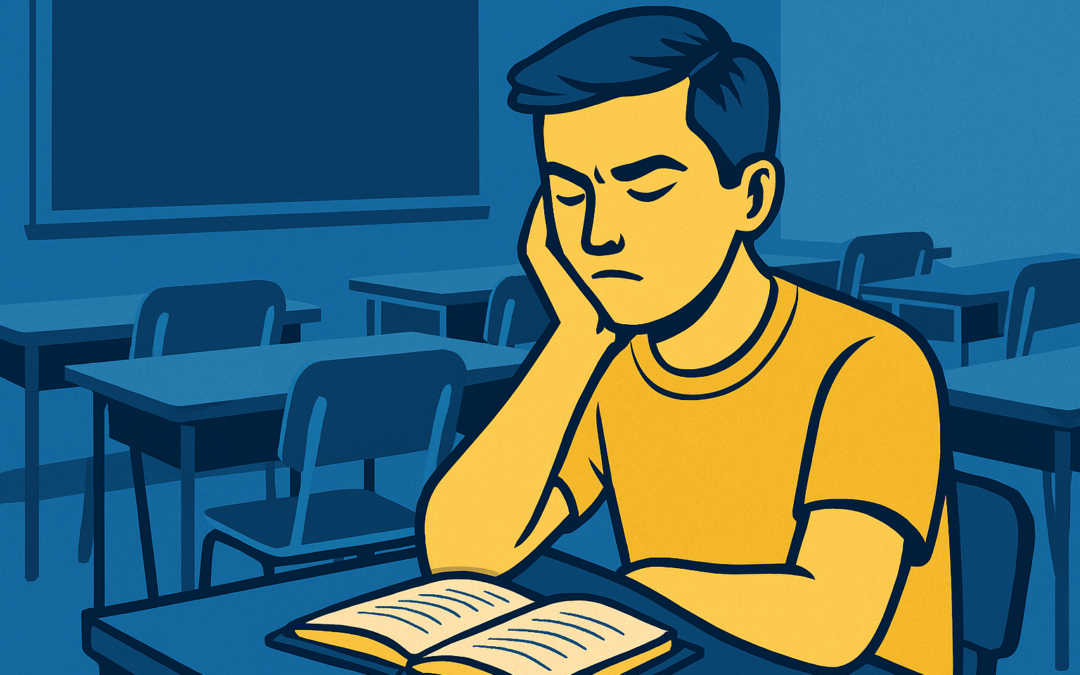3 juin 2024 – Sarah Jurisch Praz
L’ALIÉNATION :
UN CONCEPT UTILE
DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION
Table des matières
1. L’aliénation selon Marx
2. L’aliénation dans le domaine de la formation
2.1. Aliénation par rapport au produit du travail
2.2. Aliénation dans le processus de travail
2.3. Aliénation par rapport à la nature humaine
2.4. Aliénation par rapport aux autres
3. Sortir de l’aliénation
4. L’aliénation : un outil pour améliorer l’apprentissage
4.1. … du point de vue des stratégies d’enseignement
4.2. … du point de vue des stratégies d’apprentissage
5. Conclusion
6. Bibliographie
1. L’aliénation selon Marx
Le concept d’aliénation est central dans la pensée de Marx (Marx, 1972). Selon lui, l’aliénation se réfère à la condition dans laquelle le travailleur devient étranger au produit de son propre travail et à son propre être. Dans les Manuscrits économiques et philosophique de 1844, Marx définit quatre formes spécifiques d’aliénation :
• L’aliénation par rapport au produit du travail : ce que la ou le travailleur produit par son travail ne lui appartient pas à lui, mais au capitaliste qui possède les moyens de production. Le produit du travail devient ainsi une puissance indépendante qui s’oppose au travailleur.
• L’aliénation dans le processus de travail : le travailleur est aliéné dans le processus de travail lui-même, car ce processus est contrôlé par qqn d’autre (le capitaliste). Le travailleur n’a pas de contrôle sur ses propres activités et devient un simple appendice de la machine. Le travailleur est réduit à un exécutant de tâches.
• L’aliénation par rapport à la nature humaine : pour Marx, le travail est une expression fondamentale de la nature humaine, mais le capitalisme en fait une activité qui aliène l’être humain de sa propre humanité. Plus largement, cette forme d’aliénation se manifeste lorsqu’il y a déconnexion entre les activités d’un individu et ses véritables capacités et besoins humains.
• L’aliénation par rapport aux autres : comme le capitalisme divise les individus et les met en concurrence les uns avec les autres, les relations sociales se réduisent à des relations marchandes et les individus deviennent étrangers les uns aux autres.
Ces formes d’aliénation sont interconnectées et tendent à coexister dans le système capitaliste. Elles se renforcent mutuellement. Cependant, toutes ne doivent pas nécessairement se manifester pour qu’un travailleur soit considéré comme aliéné. Une seule forme suffit à produire un état d’aliénation.
2. L’aliénation dans le domaine de la formation
Si Marx s’est attaché particulièrement au monde du travail, dans un contexte capitaliste, il apparaît que les quatre formes d’aliénation qu’il a identifiées peuvent se manifester dans le système de formation tel que nous le connaissons aujourd’hui.
2.1. Aliénation par rapport au produit du travail
Dans le domaine éducatif, le produit du travail des apprenants se traduit en connaissances et compétences qui sont bien souvent définies dans des curriculums rigides et standardisés, construits et mis en oeuvre indépendamment des spécificités de chacun.e. On peut parler d’aliénation lorsque les apprenants ne perçoivent pas la pertinence ou l’utilité de ce qu’elles et ils apprennent et qu’elles et ils considèrent que les résultats de leurs apprentissages servent plus des objectifs externes (comme les exigences du marché du travail) que leurs propres aspirations. L’aliénation peut se manifester par l’apprentissage mécanique des matières imposées par le programme.
2.2. Aliénation dans le processus de travail
Des méthodes d’enseignement sont standardisées, voire autoritaires, peuvent être aliénantes dans ce sens qu’elles ne permettent pas aux apprenants de faire preuve d’autonomie ou de créativité dans leur manière d’apprendre. Les apprenants, ainsi dépossédés de leur manière personnelle d’apprendre (leur processus d’apprentissage), deviennent de simples récepteurs passifs.
2.3. Aliénation par rapport à la nature humaine
Lorsque le système éducatif force les apprenants dans une voie qui ne leur correspond pas, que ce soit en termes de contenus de formation ou de méthodes d’enseignement, on peut parler d’aliénation. En effet, cette forme d’aliénation se manifeste par un décalage entre les activités de l’individu (la manière d’apprendre et les connaissances et compétences travaillées) d’une part, et ses intérêts, besoins ou talents personnels d’autre part. Ainsi, la conformité à la forme et aux normes scolaires, un enseignement strict et autoritaire, le manque de reconnaissance des besoins et aspirations individuels sont autant de manifestations de cette forme d’aliénation.
2.4. Aliénation par rapport aux autres
Par la compétition que le système scolaire peut encourager (au travers des notes par exemple), les apprenants deviennent des concurrents dans un espace qui les classe et les catégorise (en bons / mauvais élèves). Il s’agit d’une aliénation sociale au sens de la perte d’un collectif solidaire.
3. Sortir de l’aliénation
Pour éviter ou limiter l’aliénation des individus, trois voies sont notamment envisagées dans la pensée de Marx : l’émancipation, la réalisation de soi et l’appropriation de son propre travail. L’émancipation représente la libération des conditions d’oppression et d’aliénation imposées aux travailleurs et implique la reconquête du contrôle sur le produit de leur travail, sur le processus de travail lui-même, et, plus largement, sur leur propre vie et leurs relations sociales.
Dans le domaine éducatif, l’émancipation peut sembler difficile à atteindre, en particulier dans le cadre de l’école obligatoire. Il est toutefois possible de s’appuyer sur des méthodes d’enseignement visant à développer l’esprit critique pour donner aux apprenants les moyens de leur émancipation.
La réalisation de soi (ou auto-réalisation) est un état où les individus sont capables de développer pleinement leurs capacités et potentialités. Cela signifie que le travail devient une activité auto-expressive et satisfaisante, permettant aux travailleurs de s’épanouir et de s’identifier positivement avec leurs activités.
En formation, un travail sur le sens, tel qu’il est perçu par les apprenants, peut permettre de soutenir leur auto-réalisation. Il est aussi possible d’impliquer les individus au travers de leurs intérêts, talents, conception du monde, etc. Plutôt que de proposer une seule forme d’évaluation, impliquer les apprenants dans la manière dont elles et ils vont rendre compte de leurs apprentissages peut représenter un levier en termes de motivation et d’implication. Envisager différentes formes de travaux pour évaluer les connaissances et compétences acquises en formation, permet à la créativité des apprenants de s’exprimer.
L’appropriation de son propre travail désigne la capacité des travailleurs à s’approprier pleinement le produit de leur travail et le processus de production, plutôt que d’être soumis aux diktats du capitalisme.
Amener les apprenants à réfléchir aux raisons qui les ont amenés à entreprendre cette formation ou à ce qu’elles et ils pourront transférer dans leur vie future peut les aider dans ce travail de réappropriation. En termes de processus d’apprentissage, il est aussi envisageable de les impliquer dans la construction des cours, au travers d’activités participatives par exemple.
4. L’aliénation : un outil pour améliorer l’apprentissage…
4.1. … du point de vue des stratégies d’enseignement
Les systèmes éducatifs jouent un rôle fondamental dans le développement des connaissances et compétences des apprenants, et ce à tous les âges de la vie. Le concept d’aliénation de Marx nous permet de les comprendre comme des espaces aliénants, au sens où ils contribuent à créer l’aliénation des apprenants. Toutefois, il est possible pour les enseignants qui évoluent dans ces espaces de limiter leurs effets aliénants et ainsi de tendre à constituer des espaces d’apprentissage plus favorables aux individus.
Voici quelques exemples :
• Rendre l’apprentissage pertinent et significatif : en explicitant l’utilité des contenus enseignés en classe, au travers d’exemples pratiques et diversifiés.
• Privilégier les méthodes d’enseignement participatives : afin de valoriser l’autonomie, la créativité et l’engagement actif des apprenants, tout en leur permettant de les expérimenter dans un cadre sécurisant.
• Respecter les différences individuelles : reconnaître et valoriser les talents et intérêts uniques de chaque apprenant, tout en mettant en lumière la diversité des talents qui constituent le groupe (classe, école, société).
• Favoriser la coopération et la solidarité : contribuer à créer un environnement scolaire qui encourage la collaboration plutôt que la compétition, en valorisant le travail d’équipe et le soutien mutuel.
4.2. … du point de vue des stratégies d’apprentissage
Si les systèmes d’apprentissage sont relativement stables dans le temps et entre les écoles, chaque apprenant en fait une expérience singulière. Ainsi, dans des systèmes que l’on peut qualifier d’aliénants, les individus peuvent expérimenter l’aliénation scolaire de manières très différentes selon leur situation personnelle, voire la vivre de manière marginale.
Selon nous, la difficulté en termes d’apprentissage peut être comprise comme une aliénation scolaire ou de formation. Il est donc pertinent de s’appuyer sur des outils favorisant l’émancipation de l’apprenant, son auto-réalisation ou l’appropriation de son propre travail. A ce titre, le Modèle de Développement Humain – Processus de Production du Handicap (MDHPPH) (Réseau International sur le Processus de Production du Handicap – RIPPH, 2024) est un outil très performant pour accompagner l’émancipation des personnes.
En effet, il permet d’envisager toutes sortes de situations de vie. Il représente une opportunité pour analyser l’apprentissage, dans le sens où une situation d’apprentissage réussie est le résultat d’un équilibre entre facteurs personnels et facteurs environnementaux. Il n’existe pas en soi un modèle reproductible de facteurs qui favoriseraient l’apprentissage pour tout le monde.
Toutefois, ce support permet de repérer les facteurs qui induisent une aliénation, tant au niveau personnel (identitaire ou organique) qu’au niveau environnemental (micro, méso, macro). En outre, tel qu’il est construit, il permet l’émancipation de l’individu face aux systèmes eux-mêmes, mais aussi par la prise de conscience des effets aliénants de ces derniers.
Par ailleurs, la gestion mentale et plus particulièrement le dialogue pédagogique (de La Garanderie, 2013) nous semblent tout à fait pertinents pour accompagner l’auto-réalisation des individus aliénés par le système éducatif dans lequel ils évoluent. En effet, l’exploration par l’individu de sa manière d’appréhender le monde, de se le représenter mentalement et finalement d’apprendre est cruciale pour lui permettre de s’exprimer pleinement.
C’est aussi ce qui lui permet :
• de se réapproprier le produit de son travail en mettant au coeur de sa réflexion ses aspirations personnelles, les objectifs qu’il poursuit, le sens de cette formation (aliénation par rapport au produit du travail) ;
• de s’engager dans un processus d’apprentissage dynamique, actif et adapté à son mode de fonctionnement mental (aliénation dans le processus de travail) ;
• d’envisager d’intégrer certaines manières de faire qui lui sont moins « naturelles » ou plus éloignées de ses aspirations, ce qui lui permet de s’adapter à une certaine forme scolaire sans pour autant se trahir (aliénation par rapport à la nature humaine) ;
• de valoriser sa manière d’apprendre sans dévaloriser les autres, mais aussi de prendre conscience de la diversité des manières d’apprendre qui coexistent sans compétition (aliénation par rapport aux autres).
5. Conclusion
En conclusion, le concept d’aliénation développé par Karl Marx semble garder toute son actualité et même s’élargir à de nouveaux domaines de la vie, dans notre société capitaliste et libérale.
Penser l’aliénation de l’apprenant nous permet de comprendre la démotivation des individus face à leur formation, leur(s) difficulté(s), la perte de sens dont la presse se fait régulièrement l’écho, mais surtout ce concept nous permet d’envisager des pistes pratiques pour accompagner les apprenants dans leur parcours d’apprentissage.
6. Bibliographie
de La Garanderie, A. (2013). Réussir, ça s’apprend. Bayard.
Marx, K. (1972). Manuscrits de 1844. Economie politique et philosophie. Paris: Les Editions
sociales.
Réseau International sur le Processus de Production du Handicap – RIPPH. (2024).
Modèle du MDH-PPH. – Récupéré sur Réseau International sur le Processus de Production du Handicap
– RIPPH: https://ripph.qc.ca/modele-mdh-pph/le-modele/